Finance et littérature
août 14, 2022
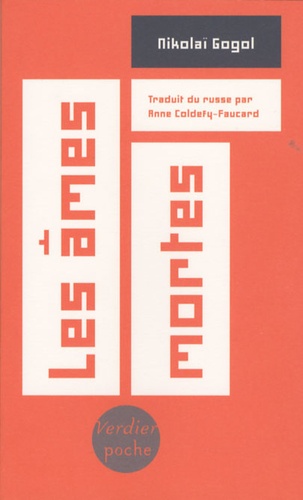
Alors que je naviguai dans la liste des 100 meilleurs livres de tous les temps à la recherche d’un roman à lire cet été sur la plage, j’ai été attirée par un résumé laconique du roman phare de Nicolas Gogol, « Les âmes mortes » : un homme rachète des serfs morts pour se créer un domaine fictif qui lui permet d’obtenir un crédit hypothécaire. Ni une ni deux, l’employée de banque que je suis depuis trente ans y voit l’inconciliable : un roman qui parle aussi de finance et de techniques financières.
C’est un fait, la littérature n’aime pas parler de la finance. A mon grand regret, les deux domaines qui sont aussi mes deux passions ne se croisent que très rarement et quand la littérature daigne parler de finance, c’est rarement en des termes élogieux, ou même neutres, la finance et les financiers se voyant croqués le plus souvent grossièrement ou sous des clichés éculés.
De mes souvenirs anciens ou récents de lecture, seul Maurice Druon a glissé dans les Rois Maudits quelques explications sur la façon dont les rois des XIIeme et XIIIeme siècles finançaient leur train de vie et leurs guerres avec des instruments inventés par des banquiers lombards (lettres de crédit, intérêts, lettres de gage, collatéral, etc.). Thomas Piketty a bien aussi, un peu plus tard, pour son « Capital au XXIeme siècle », épluché les auteurs anglais, français et russes des XVIIIème et XIXème siècle pour déduire des rentes et capital affichés dans les romans le taux de rendement du capital à long terme en Europe, mais ce n’est pas à proprement de la littérature.
Je me suis donc réjouie de lire le résumé des Âmes mortes, anticipant que c’est un auteur russe qui viendrait me parler du sujet qui résume si bien le capitalisme.
Du point de vue de la finance, le roman de Gogol, qui se passe dans les années 1810, commence bien. Son héros, Tchitchikhov, dont on perçoit vite l’immense cynisme, visite des fermes pour acheter des serfs morts. En Russie, tout propriétaire terrien qui possède aussi des serfs paye une capitation, un impôt basé sur le nombre d’individus. Cet impôt n’est revu et ajusté que tous les cinq ans après recensement. Entre deux recensements, naturellement, des serfs meurent. Le propriétaire doit pourtant continuer à payer l’impôt même si l’individu n’est plus « productif » et ce pendant encore potentiellement plusieurs années. Au même moment, d’autres serfs naissent mais il faut aussi attendre quelques années pour que ces jeunes enfants soient à leur tour productifs. Les fermiers visités par Tchitchikov comprennent vite, voire très vite, leur intérêt immédiat à céder des cerfs décédés. Ils se voient délestés immédiatement d’un impôt et certains se précipitent pour vendre à très bas prix leurs « âmes mortes ». (Le roman semble indiquer que les serfs sont attachés à une terre et à un propriétaire et donc qu’il n’est pas possible de les vendre, morts ou vivants. Cette contradiction ne sera pas levée dans le roman et Tchitchikov continue à faire ses emplettes.)
D’autres plus malins s’interrogent sur l’intérêt de Tchitchikov à acheter ces noms d’individus morts et, faute de réponse claire, négocient âprement le prix des serfs cédés, anticipant que Tchitchikov devait avoir un intérêt caché mais réel à faire ces transactions. Les individus sont identifiés par leurs noms, prénoms, dates de naissance et de mort, leur surnom et leurs principales qualités de leur vivant. Les âmes mortes de sexe féminin ne sont pas cessibles au début du roman car sans valeur mais le deviennent dans la deuxième partie. Cette contradiction ne sera pas non plus levée.
Il faut attendre d’avoir bien avancé dans la deuxième partie pour comprendre le bénéfice que veut tirer Tchitchikov de ses achats : fort de milliers d’âmes achetées à un prix excessivement bas, Tchitchikov les fait passer pour des serfs vivants et s’en sert comme nantissement pour emprunter auprès d’un banquier lombard une somme importante. Avec cette somme, il achète une terre bien réelle et d’autres serfs bien vivants pour la cultiver et lui procurer un revenu suffisant pour à la fois rembourser son emprunt et vivre très confortablement avec sa femme et ses onze enfants. L’escroquerie consiste, au final, à emprunter avec une ridicule mise de départ puis à tricher sur la valeur du collatéral donné à la banque qui consent le prêt. La technique de fraude est, somme toute, excessivement banale. Ce qui l’est moins, c’est que le collatéral est de l’humain (vivant ou mort) mais la technique en elle-même est des plus classiques.
Gogol n’a pas imaginé l’escroquerie, c’est Tolstoi qui lui en a soufflé l’idée après avoir entendu parler de la manœuvre qui était pratiquée dans la Russie de la première moitié du XIXeme siècle. Gogol s’en est servi comme base d’une histoire visant à dénoncer la décadence des nobles et la vilénie de la servitude en Russie, et non pour écrire, à mon grand dam, un roman financier !
Tchitchikov mène son projet à bien, il achète ses terres comme prévu. Sur le long terme, il s’avère qu’il luttera contre tout ce qui aurait pu améliorer le sort des 1400 familles qu’il finit par détenir. Gogol interdit à son héros les idées d’équité, d’amélioration sociale, de morale universelle, de propagation des lumières vis-à-vis de ses serfs, comme il ne reconnaît à ses filles que des besoins de rubans et de leçons de danse en préparation de leur dot et de leur trousseau.
Gogol attribue aussi à son personnage un patriotisme « grand-Russien » qui ne reconnaît à ce qui vient de l’étranger rien qui ne puisse être mieux que ce qu’est en mesure de produire la Russie. Et si Tchitchikov est amené, malgré son patriotisme, à écouter un opéra italien ou à souhaiter que ses enfants apprennent le français, il veut que l’opéra soit chanté par un ukrainien et que les cours soient donnés par un juif russe, rejetant par là tout contact avec l’étranger. Et s’il accepte de frayer « à la rigueur » avec des juifs, c’est uniquement parce que ces derniers pouvaient être envoyés manu militari en déportation en cas d’incartade ou de désobéissance.
Gogol dénonce au final la mainmise de 300 000 riches hommes et femmes aidés d’un million d’hobereaux corrompus sur la vie de 30 millions de familles en servitude. La dénonciation fut louée et connut un énorme retentissement lors de la sortie du livre. Même si je n’ai voulu voir dans les âmes mortes qu’un roman financier, il n’en était au final rien, il s’agissait, une fois de plus, de parler de la condition humaine.
Lu Xun
décembre 19, 2021
« Ah ! C’est un auteur très connu mais qui ne pourrait plus écrire comme il l’a fait, chez nous, maintenant, car il dit des choses pas très jolies sur la Chine. » Mon collègue chinois à qui je parle de ma dernière découverte littéraire connait bien Lu Xun que Wikipedia présente comme père fondateur de la littérature chinoise contemporaine. En France, Lu Xun est plus que confidentiel, seuls deux minuscules fascicules de nouvelles – Lu Xun n’a pas écrit de romans – semblent avoir été publiés récemment chez un petit éditeur, les Editions Sillage. Pour faire plus, il faut aller acheter sur Rakuten des fascicules des années 1980 édités en Chine même, le tout à des prix ridiculement bas.
Le premier recueil, « le journal d’un fou », ne contient qu’une toute petite mise en bouche de 6 nouvelles et totalise moins de 100 pages. Dès les premières pages, la réflexion de mon collègue chinois prend tout son sens : Lu Xun est dans la veine naturaliste et pas là pour nous conter une Chine de façade. Les nouvelles du recueil ont été écrites dans les années 1920, après la chute de la dynastie des Qing, et se penchent sur une population encore bien pauvre et illettrée. Les six nouvelles se passent chez les « courts-vêtus » aux « ongles courts », deux signes de pauvreté quand porter une longue robe et avoir des ongles longs sont deux signes qu’on ne travaille pas dans les champs ou de ses mains, et donc qu’on appartient à une classe sociale supérieure.
La première nouvelle, le journal d’un fou, est toute surprenante : il s’agit des divagations d’un paranoïaque sur les 4000 mille ans de cannibalisme qu’aurait vécu la Chine et plus directement, sur les doutes qui l’étreignent alors qu’il soupçonne d’avoir lui-même gouté de sa petite sœur à sa mort, servie dans le dîner par son frère. N’était-ce le titre, le texte très maîtrisé et la pensée très claire de la nouvelle pourraient laisser planer le doute sur le passé cannibale de la Chine raconté par l’auteur.
Les nouvelles suivantes peignent des moments de vie de l’homme de la rue : l’histoire d’un client qui fréquente régulièrement un café et finit par ne plus venir, la mort d’un enfant, la nostalgie d’un adulte qui revient dans le village de son enfance et la distance qui s’installe entre lui et son ami d’enfance qui est resté au village et a moins bien réussi que lui. Si les thèmes des récits pourraient avoir tout aussi bien été imaginés en occident, ils mettent en exergue des coutumes brutales : le remède pour l’enfant malade est un petit morceau de pain trempé dans le sang d’un condamné, ce même condamné a été trahi par un membre de sa famille poussé à la délation car si le coupable n’est pas dénoncé, c’est toute la famille qui se voit condamnée ; un voleur se fait, en guise de punition, casser les jambes.
C’est peut-être ça que les autorités chinoises ne voudraient pas voir étalé aux yeux de l’occident : une époque dont les us feraient écarquiller les yeux de l’occident, il y a moins d’un siècle, narrée par un écrivain qui a eu, à moment donné, envie de raconter ses voisins, ses frères, les siens. Qu’il ne se soit passé qu’un siècle depuis les scènes racontées par Lu Xun en dit long sur les changements par lesquels sont passés la Chine et sa population depuis lors. La Chine en est sans doute très fière et à mes humbles yeux, elle peut l’être !
L’oie de Noël
décembre 16, 2021
Je n’ai pas touché un bon livre depuis des mois ! J’ai lu trois milles pages de Dostoievsky d’affilée pendant les trois confinements et ma lecture m’a laissé épuisée. Je suis sortie de mes trois marathons de lecture successifs (Crime et châtiment, l’Idiot et les frères Karamazov) avec la sensation de ne plus pouvoir avaler le moindre texte, gavée jusqu’à l’indigestion de personnages introduits dans ma vie. Cette impression, diffuse mais croissante à mesure que j’absorbais les centaines de milliers de mots, s’est renforcée l’été dernier quand mes filles m’ont lancé un défi : alors que je m’étonnais que les frères Karamazov ne soit pas résumé dans Wikipedia, elles m’ont incitée puis poussée à le faire. Je n’avais jamais contribué à Wikipedia, ni sur le fond en écrivant un article, ni sur la forme en l’enregistrant dans un système contributif. J’ai été tentée de relever leur défi même si j’ai réalisé l’ampleur du travail à fournir : j’ai vite compris que si personne n’avait résumé les frères Karamazov avant moi, c’est qu’il y avait une excellente raison : le temps à y consacrer est colossal.
Aussi mon été s’est-il transformé en pensum littéraire, mes heures de lecture se sont accompagnées d’heures de prise de notes sur mon téléphone et sur la plage. Le résumé m’a pris des dizaines d’heures, littéralement, en plus du temps de lecture. J’en ai oublié au passage le plaisir que je devais y prendre : la joie de lire a laissé la place à la nécessité de saisir tous les détails d’une histoire bien compliquée, mais le résumé, in fine, a bien été posté sur Wikipedia.
Je suis heureuse du résultat, des modifications ont depuis été ajoutées qui me donnent le sentiment d’avoir apporté ma pierre à un certain édifice. Mais j’ai posé le stylo de mes études il y a de nombreuses années en pensant qu’il m’appartenait alors de choisir comment passer mon temps. J’aide peut-être aujourd’hui quelque étudiant en russe qui peine sur le livre et trouve en mon résumé sur Wikipedia une aide salvatrice mais, de façon très égoïste, la satisfaction que j’ai retirée de cet exercice a été bien minime.
Après cet été studieux, je me suis gavée de vidéos parfois intéressantes, mais le plus souvent ineptes, sur les réseaux sociaux. Le système de récompense de Facebook qui consiste à vous alimenter en continu du même type de vidéos que celle que vous venez de regarder a parfaitement fonctionné sur moi. Avec toute la bonne volonté du monde, je n’ai pas réussi à m’abstraire de ma dose quotidienne de une à deux heures de recettes de cuisine, de défis de bricolage dont la seule finalité est de vous garder le plus longtemps en ligne et de sentimentalité lors de retrouvailles de familles écartelées. Je m’étonne de mes voisins d’en face dont la télévision est allumée douze heures par jour mais j’ai pris la même pente en me gavant de vidéos qui nécessitent encore moins d’efforts de concentration que la télévision.
L’orgie d’inanités avalées pendant tout l’automne a fini par me dégoûter et par faire resurgir le besoin d’évasion que me procure un bon livre. La liste de livres dans laquelle je pioche régulièrement, les 100 meilleurs livres de tous les temps du Cercle Norvégien du livre, ne m’a procuré à peu près que du plaisir. Chacun des livres lus s’est avéré unique. Je les ai refermés quasiment à chaque fois avec la sensation d’être entrée dans des univers singuliers dans lesquels nul autre auteur ne m’avait jamais transportée.
Le voyage n’est pas toujours simple : rejoindre l’écrivain sur son terrain pour suivre ses pensées et participer à la vie de ses personnages ne se fait pas sans l’effort de s’abstraire de son propre réel et d’être actif dans ce voyage en terre inconnue. Le passage de l’un à l’autre monde est délicieux : entrer dans l’univers d’un auteur puis en ressortir pour reprendre le quotidien me procure le sentiment de vivre en simultané deux vies tout aussi nécessaires l’une à l’autre. Seules, ni l’une ni l’autre ne me suffiraient. Ma vie quotidienne me plait mais j’ai besoin de la pimenter de cette autre vie imaginaire. Et je n’aimerais pas ne faire que lire, j’ai besoin aussi d’un quotidien terre-à-terre fait de tâches familiales et professionnelles routinières.
Au-delà de la multiplication de vies qui m’ont été offertes par tous ces écrivains géniaux, rien ne me trouble plus que quand je me prends à lire la description d’une émotion que j’ai déjà moi-même ressentie un jour, à moment donné, dans un passé lointain ou plus récent. Cela m’arrive parfois, ce n’est pas courant mais ce n’est pas non plus rare et la sensation que ce moment me procure est simplement divine. Le phénomène m’émeut beaucoup : comment moi, femme vivant au XXIème siècle, dans ma cuisine parisienne, puis-je ressentir la même sensation qu’un homme cent ou deux cents ans auparavant qui décida alors de la décrire par des mots ? Qu’ont en commun nos deux individualités aux vies si éloignées pour ressentir les mêmes émotions ? De nombreux chercheurs ont sans doute des explications très savantes au côté cathartique de la littérature. Ce que je sais c’est que vivre ces moments de lecture me donne l’impression que l’auteur parle de moi, j’en retire une jouissance surement très narcissique mais surtout très intense. Je cherche ces moments alors bien sûr je les trouve plus dans des auteurs qui brodent autour des émotions de leurs personnages que dans les polars ou les romans d’action.
Et puis je recherche le style, la poésie sans les vers, les phrases joliment équilibrées. Le style pour moi c’est le confort : celui de lire sans anicroche, sans le petit caillou qui fait trébucher la pensée, celui qui rend évident l’enchaînement des mots. Le style, ça doit être un peu comme la récompense de Facebook, l’assurance d’une petite musique connue que rien ne viendra troubler mais qui satisfait un besoin de sécurité bien bas dans la pyramide de Maslow.
J’ai abandonné l’idée de lire les 107 chapitres des essais de Montaigne, il ne s’agit pas de se dégoutter à nouveau d’une lecture trop difficile et trop longue. Je vais y aller doucement et commencer par remettre un tout petit doigt de pied dans une eau qui a été trop froide l’été dernier. Je vais recommencer par six petits nouvelles de Lu Xun en moins de 90 pages. L’auteur que je ne connais pas est plein de promesses. Sa fiche Wikipedia le présente comme le principal auteur chinois de la littérature contemporaine. Lu Xun a écrit 700 nouvelles, si la mise en bouche des six petites textes me plait, il me restera de quoi faire !
En 67 langues sur Wikipedia
août 29, 2021
Lire ne peut pas se réduire à une performance mais quand on attaque les Frères Karamazov en même temps que se déroulent les jeux olympiques, on ne peut pas s’empêcher d’y mettre quelques chiffres : l’histoire est longue, très longue, 1200 pages et 300 000 mots, et le livre de 500 g est lourd sur la plage…
Avant d’ouvrir le livre à la première page, on a bien un petit moment d’appréhension, on se demande pourquoi s’infliger ça, une telle lecture, alors que d’autres livres requièrent tellement moins d’efforts et de temps. Mais la curiosité l’emporte, on a envie de comprendre pourquoi le roman devant soi a pris une telle place dans les références littéraires de la planète, pourquoi il parle assez à l’humanité pour avoir droit à un article en 63 langues dans Wikipedia.
Mince, encore un chiffre…
Et pourtant, ce summum de la littérature criminelle – car il s’agit de résoudre un crime perpétré sur un vieil homme, Fiodor Karamazov, par, on le soupçonne, l’un de ses quatre fils – ne commence vraiment qu’à la page 600.
J’exagère… un tout petit peu.
Sur la première moitié du livre, que j’ose à pein appeler introduction, Dostoïevski prend le temps de présenter les personnages – toujours très nombreux – de son histoire, leur caractère et leurs relations, leur histoire passée et leur histoire présente et pour décrire le contexte de la Russie d’alors. Rien que du très classique. Dostoïevski donne aux quatre fils Karamazov des caractères bien tranchés : Alexis le plus jeune est pur et représente le bien, Dimitri, l’aîné est tempétueux et Ivan, l’enfant du milieu, est un érudit athée. Smerdiakov, le quatrième, serait un enfant naturel du père et l’un de ses serviteurs, intelligent mais aussi condamné par une épilepsie invalidante – tout comme Dostoïevski d’ailleurs qui était atteint du même mal.
Dans ce long préambule, l’auteur fait aussi de très longues digressions sur les valeurs de l’église orthodoxe et sur les starets, maîtres spirituels ascétiques habitant des ermitages près des monastères. Zossima, un anachorète d’un monastère voisin de la propriété des Karamazov, prend une place conséquente : Alexis s’y attache au point de vouloir entrer dans les ordres à son tour et les Karamazov le font intervenir comme médiateur pour tenter d’apaiser leurs tensions familiales.
Au-delà de ce rôle au cœur de l’histoire, Dostoïevski transcrit longuement, très longuement l’enseignement du starets Zossima et disserte sur le bien, le mal, la compassion, l’humilité, etc. Il donne par la même occasion des petits coups ici et là au rationalisme, au nihilisme et au socialisme qui imprégnaient alors la Russie de la deuxième moitié du XIXème siècle, et autant dire que Dostoïevski ne portait pas le message de ces idéologies naissantes qui bouleversèrent pourtant radicalement son pays trente cinq ans plus tard. Le moine Zossima hante donc les 600 premières pages du roman avant que Dostoïevski le fasse mourir. Il disparaît ensuite totalement de la deuxième moitié en laissant le curieux sentiment que Dostoïevski avait des choses à dire qui n’avaient pas grand-chose à voir avec l’histoire du crime, et que c’est ce personnage colossal mais temporaire qui lui a permis de porter son message.
Vient la deuxième partie et son spectaculaire assassinat. Sur les quatre fils de Fiodor Karamazov, trois ont des raisons d’avoir perpétré le crime. Alexis, candidat au staretsvo, est le seul à ne pas être soupçonné. Mais les trois autres pourraient tous avoir tué ce père qu’ils haïssent : Dimitri, parce que celui-là l’a spolié de l’héritage de sa mère, Ivan, parce qu’il craint que l’argent de son père aille à une jeune femme que ce dernier convoite d’épouser, ou Smerdiakov, parce qu’il sert ce père colérique dont il n’a rien reçu et ne recevra rien du fait de son statut de fils illégitime.
C’est surtout dans cette deuxième partie que Dostoïevski excelle dans la narration si bien que le roman s’avale comme une série de télévision. L’histoire fut publiée pour la première fois sous forme de feuilleton, ce qui donne un format de narration particulier : les chapitres sont courts et se concluent toujours par un teaser sur le chapitre suivant. Les moments qui entourent le crime sont disséqués à l’envi, comme si le cinéaste Dostoïevski nous repassait son film image par image pour bien comprendre la genèse du crime, et nous le projetait tel que vu tour à tour par les différents protagonistes.
Au-delà du format qui nécessite des redites pour rafraichir la mémoire du lecteur qui lit de façon intermittente, les  personnages et les situations sont brossés en quelques paragraphes terriblement vivaces. Dostoïeski n’introduit jamais un personnage sans rappeler son enfance, sa position dans la société et ses derniers faits d’armes, et rajoute ainsi à chaque fois des histoires dans l’histoire.
personnages et les situations sont brossés en quelques paragraphes terriblement vivaces. Dostoïeski n’introduit jamais un personnage sans rappeler son enfance, sa position dans la société et ses derniers faits d’armes, et rajoute ainsi à chaque fois des histoires dans l’histoire.
L’écrivain n’omet pas dans ses descriptions saisissantes de se faire l’avocat de la Russie qui souffre : de femmes qui deviennent « possédées » tant leurs conditions de vie dans les campagnes sont exécrables, des enfants qui trainent les rues en haillons et qui meurent de faim ou sous les coups de leurs parents, des femmes et des hommes âgés qui ne se sont jamais extirpés du servage dont ils ont pourtant été légalement libérés vingt ans plus tôt. La souffrance reste aux yeux de Dostoïevski la condition du peuple russe et il le martèle. Mais, tout emprunt de christianisme orthodoxe, il fait ouvrir le récit vers mille possibilités de délivrance de cette souffrance par le biais de la générosité et de la gentillesse. Alexis en est le symbole : il fait le bien, ici avec ses frères, là avec la famille Sneguirev qui prend une place importante, et devient une figure idéale jusqu’aux dernières lignes du roman qui portent un magnifique message d’espoir.
La lecture des frères Karamazov est bien une performance (mais son écriture a dû en être une d’une autre ampleur) ! L’histoire est longue, le livre aurait sans doute pu faire 200 ou 400 pages de moins – rien que ça – mais c’est le roman par excellence : une description intime du contexte, des protagonistes qu’on connait mieux que soi-même, des situations qu’on a presque vécues, l’universalité des émotions exprimées, un rythme haletant, un parti pris de l’auteur incontestablement bien argumenté même s’il n’est pas partagé. Au final, les frères Karamazov valent bien 67 langues sur Wikipedia !
Out of Africa
novembre 29, 2020
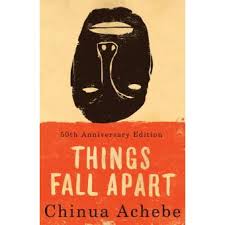 Des 100 meilleurs romans de tous les temps du cercle du livre norvégien, un seul a été écrit par un auteur africain et ce n’est pas un roman gai. Things fall apart, de l’écrivain nigérian Chinua Achebe, raconte le quotidien du clan d’Umuofia où vit Okwonko, à la fin du XIXème siècle. Okwonko, de la tribu Igbo, s’extrait de la misère à force de travail pour devenir un des personnes influentes du village. Il a trois femmes, huit enfants, les huttes nécessaires pour loger sa famille et ce qu’il faut pour la nourrir.
Des 100 meilleurs romans de tous les temps du cercle du livre norvégien, un seul a été écrit par un auteur africain et ce n’est pas un roman gai. Things fall apart, de l’écrivain nigérian Chinua Achebe, raconte le quotidien du clan d’Umuofia où vit Okwonko, à la fin du XIXème siècle. Okwonko, de la tribu Igbo, s’extrait de la misère à force de travail pour devenir un des personnes influentes du village. Il a trois femmes, huit enfants, les huttes nécessaires pour loger sa famille et ce qu’il faut pour la nourrir.
Pendant la moitié du roman, sa vie est scandée par le travail agricole, les naissances et les morts, les rites ancestraux et les guerres entre villages. Il a la main ferme et volontaire sur ce qu’il maîtrise : la somme de travail qu’il peut fournir, son foyer qu’il gère à coups de triques, les rapports avec les autres villageois. Ce qu’il ne maîtrise pas, la sécheresse, les enfants qui meurent en bas âge, les mauvaises récoltes, les problèmes de santé, il les attribue à la colère des dieux et déesses. Il consulte prêtres et oracles qui en sont les intermédiaires et qui ordonnent ce qu’il faut de sacrifices pour satisfaire les dieux : un coq pour une bonne récolte, une chèvre, une poule, une pièce de tissu, des coquillages et à l’occasion, un enfant.
Et puis un jour s’installent des missionnaires dont un blanc. Ils construisent dès leur arrivée une église dans le pire endroit qu’on ait daigné leur attribuer, la « forêt du mal ». A la surprise du village, la mission prospère en ce lieu pourtant promis au pire. A la surprise du village aussi, les missionnaires convertissent les indésirables du village : Nwoye, le fils homosexuel d’Okwonko ; Nneka, une femme qui ne met au monde que des jumeaux promis par tradition à l’infanticide ; des osu, parias appartenant à la plus basse caste du village. Plus tard, le missionnaire blanc construit une école et un hôpital. Là encore, la méfiance des villageois est totale, ils n’enverront à l’école que leurs esclaves ou les plus paresseux de leurs enfants.
Dans les dernières pages du roman, le missionnaire blanc laisse place à un révérend bien plus brutal. Les relations avec le village s’enveniment, l’église brule, le révérend fait emprisonner les incendiaires. Okwonko, prêt à lancer un soulèvement contre les blancs, finit par se suicider après avoir constaté que les autres villageois ne sont pas prêts à le suivre pour défendre les traditions et les coutumes de leur village.
On imagine sans peine les milliers d’Umuofia soumis à la colonisation en Afrique et les centaines de milliers d’Okwonko abdiquant, la violence qui dut s’y déchaîner et les soumissions qui s’ensuivirent. Le rythme de Things fall apart donne un goût des forces qui se sont affrontées sur le continent : le livre est lent sur la première moitié sans notion de temps autre que les récoltes qui se suivent et le souvenir de quelques ancêtres, sans autre horizon que le village et les quelques clans voisins. C’est bien la petite histoire qui se joue avant que la grande histoire ne vienne la balayer d’abord avec un groupe de missionnaires plutôt bienveillants puis avec des colons bien plus brutaux.
Avec ses récits imagés et une foultitude de proverbes, la narration des légendes Igbo est terriblement vivante. Les phrases sont courtes, l’action est partout, les quelques émotions sont condensées, les Igbos ne s’appesantissent pas sur leurs états d’âme, ils exultent et ils vivent le présent, la tradition orale est ici magnifiquement passée à l’écrit. Igbo comme Okwonko, Achebe raconte de la façon la plus factuelle qui soit les deux mondes qui cohabitent puis s’affrontent. Les Igbos sont imprégnés de traditions joyeuses mais ils sont aussi très barbares avec tout ceux qui n’appartiennent pas au clan. Les missionnaires, eux, commencent par apporter de bonnes choses, l’éducation et la médecine, avant de mettre à terre les villages colonisés. Achebe n’explique pas et n’émet aucun jugement, il se contente de conter sans prendre parti et sans oublier les zones d’ombre de chacun des deux camps.
Et pour insister une dernière fois sur l’océan qui sépare les colons et les colonisés, Achebe, vers la fin du livre, fait parler le « commissioner », le délégué britannique en place. Tranchant sur le reste du livre, il le fait s’exprimer dans un style froid et tout en retenue. Le commissionner se projette et réfléchit à ce qu’il ne manquera pas de raconter dans le livre qu’il écrira au retour de sa mission. Il se dit que ce chef Igbo qu’il ne nomme pas mériterait un chapitre et puis, non, peut-être juste un paragraphe : il a de toute façon tellement d’autres choses à raconter et il se refuse de se perdre dans les détails…
Guerre et vie
novembre 1, 2020
Après avoir reposé Guerre et Paix, il m’a fallu un long moment pour pouvoir m’imaginer reprendre un autre roman tant celui-là m’a habitée le temps de sa longue lecture et de nombreuses semaines après l’avoir fini. Il m’a fallu m’extraire du monde dans lequel Tolstoi m’avait happée pendant des semaines, un monde unique, entier, total, presque réel.
Guerre et Paix raconte quinze années de la vie de trois hommes, André Bolkonsky, Pierre Bezoukhov et Nicolas Rostov, et de leurs familles, entre 1805 et 1820, pendant les guerres napoléoniennes. Membres de  l’aristocratie russe du début du XIXème siècle, dévoués à leur empereur Alexandre Ier, ils vont rejoindre à tour de rôle l’armée russe pour combattre Napoléon et ses troupes qui ont déjà fait leur chemin à travers l’Autriche, la Prusse et la Pologne. Si André, Pierre et Nicolas sont des personnages purement fictifs, Tolstoi les y fait croiser les généraux qui menèrent ces guerres européennes : Napoléon avant tout bien sûr et Murat, Lauriston, Ney du côté français. Ils rencontreront aussi, côté russe, le général Koutouzow et le gouverneur Rostoptchine (le père de la Comtesse de Ségur) qui, par la mise en œuvre de la politique de terre brûlée, parvint à forcer Napoléon à la retraite et participeront ainsi à plusieurs des batailles célèbres qui ont laissé des souvenirs aussi funestes qu’Austerlitz ou Berezina.
l’aristocratie russe du début du XIXème siècle, dévoués à leur empereur Alexandre Ier, ils vont rejoindre à tour de rôle l’armée russe pour combattre Napoléon et ses troupes qui ont déjà fait leur chemin à travers l’Autriche, la Prusse et la Pologne. Si André, Pierre et Nicolas sont des personnages purement fictifs, Tolstoi les y fait croiser les généraux qui menèrent ces guerres européennes : Napoléon avant tout bien sûr et Murat, Lauriston, Ney du côté français. Ils rencontreront aussi, côté russe, le général Koutouzow et le gouverneur Rostoptchine (le père de la Comtesse de Ségur) qui, par la mise en œuvre de la politique de terre brûlée, parvint à forcer Napoléon à la retraite et participeront ainsi à plusieurs des batailles célèbres qui ont laissé des souvenirs aussi funestes qu’Austerlitz ou Berezina.
Entre deux batailles, nos trois héros rentrent en permission dans leurs familles pour vivre leur vie de jeunes hommes et de jeunes citoyens. Là, ils s’y offrent de grandes parenthèses de douceur dans l’aristocratie russe : celle-là est parfois désargentée ou tournée vers un passé plus brillant mais elle est toujours mondaine et élégante. Sa jeunesse y est pleine d’ardeur et d’espoirs, sa maturité pleine de doutes, ses femmes belles et pieuses. La partie « Paix » du livre a un côté roman à l’eau de rose : nos trois héros sont entourés de femmes plus séduisantes les unes que les autres qu’ils vont fantasmer, aimer, épouser ou quitter. Les histoires de séduction et d’amour entre princes et princesses se succèdent, elles sont simples et belles sans jamais froisser la morale, l’honneur ou la décence mais avec une très grande subtilité des sentiments.
Sans avoir mesuré précisément les chapitres de guerre et les chapitres de paix, le roman semble se partager à égalité entre le front guerrier et le front personnel des héros. Mais entrer dans Guerre et Paix, c’est bien plus qu’alterner entre les champs de bataille et les salons mondains. Par la voix de Pierre, Tolstoï s’interroge sur le sens de la vie, l’amour, la mort, l’honneur, le bonheur, le sacrifice, la religion, la liberté dans un pays où la richesse s’exprimait encore en termes de rentes et de nombre de serfs au service de ces princes. Par la voix de Marie, la sœur d’André, ou de Sonia, la cousine de Nicolas, il s’émeut du sort de jeunes femmes qui ne peuvent envisager leur propre vie faute de dot ou du fait de pères tyranniques qui les gardent égoïstement sous leur joug sans qu’elles aient rien à en dire.
Et puis par toutes les autres voix de la bonne cinquantaine de personnages qui reviennent régulièrement dans le roman, Tolstoi nous raconte la Russie d’alors : la puissance et la taille de l’empire, le servage et ses balbutiements pour en sortir, la vie anachorétique, la franc-maçonnerie, l’administration et le fonctionnariat, l’évolution des techniques agraires, la chasse à courre au loup, etc. Il raconte aussi l’autarcie dans lequel vivait l’empire : si la Russie de Tolstoi faisait venir de France et de Suisse des dames de compagnie et des précepteurs pour parler et enseigner le français, langue de la cour, l’influence étrangère sera surtout subie : c’est l’agresseur armé qui vient l’imposer de l’extérieur à un peuple sidéré d’une telle incursion.
Vue de notre Europe occidentale, la Russie d’alors pourrait nous sembler froide, isolée et triste. Et pourtant, c’est une impression de joie et d’insouciance qui finit par émaner du roman que Tolstoi, veut, malgré le contexte guerrier, plein d’espoir. Tolstoi redonne à chacun de ses personnages une chance de bonheur quelles que soient les épreuves traversées, il fait vite revivre Moscou après l’incendie qui le détruit à la retraite des troupes françaises, il récompense la résilience et l’abnégation de tous les personnages qu’il aura fait naître de sa plume.
Aussi, après quinze années de bataille, tout est bien qui finit bien dans Guerre et Paix : les jeunes séductrices ont épousé les hommes qui les entouraient, des enfants sont nés qui portent les mêmes prénoms que leurs oncles ou leurs grands-mères, des réformes vont se faire qui amélioreront le sort de tous. Tolstoi refuse de célébrer qui que ce soit de ces guerres napoléoniennes, persuadé que l’histoire ne s’écrit pas par de grands hommes qu’on loue dans les ouvrages académiques mais qu’elle est la somme d’une infinité de petites contributions humaines qui, mises bout à bout, font faire de grandes choses. Tolstoi n’eut jamais le culte d’aucun général, il se contenta, comme dans Guerre et Paix, de célébrer les énergies des individus dans une formidable ode à la vie.
Mais pourquoi Don Quichotte ?
août 27, 2020
Peut-on imaginer un roman plus entré dans l’imaginaire collectif que Don Quichotte ? Tout dans ce roman est passé dans notre vocabulaire quotidien : Don Quichotte et sa folie, la dévotion de Sancho Pancha et l’amour chimérique de Dulcinée, les luttes quotidiennes de Don Quichotte contre la réalité qui le mènent irrémédiablement vers des échecs répétés. Sans avoir jamais lu le roman de Cervantès, on est capable de décrire brièvement les personnages et d’en raconter le fil rouge.

L’épaisseur du livre – 800 bonnes pages – laisse pourtant penser qu’il y a plus que les trois lignes de résumé que je viens d’en faire. Le livre se présente comme une série d’aventures du héros malheureux et de son aide fidèle qui viennent illustrer la profonde folie de l’hidalgo qui est frappante. Un chercheur suisse en sciences cognitives et neurologiques a diagnostiqué l’espagnol comme schizophrène, paranoïaque, monomaniaque, érotomane, maniaco-dépressif et dément.
Et finalement, tous les chapitres tournent autour de cette folie dure : chaque aventure, souvent grotesque, se solde par un échec et témoigne de la santé mentale défaillante du héros. Les chapitres se suivent, les aventures se succèdent et, à moment donné, n’en finissent plus. La lecture de Don Quichotte m’a donné la même impression que celle que j’ai ressentie en lisant de l’heroic fantasy, le Décameron ou les Contes des milles et une nuit : que le fil rouge était mince et que les aventures pourraient se multiplier à l’infini sur un schéma qui revient toujours au même ; et que le livre faisait 800 pages mais qu’il aurait pu en faire 1500 ou 2000.
Don Quichotte est sans doute un régal pour les psychiatres. Pour ma part, je n’ai pas du tout été touchée et ai abandonné le livre bien avant la fin : au quart, j’avais la même impression que lorsque tous les bons moments d’un film sont condensés dans la bande annonce et que le film lui-même ne fait qu’étirer sur un temps bien trop long quelques bons moments bien sentis. Il faudra un jour quand même que je comprenne comment la légende s’est construite car pour moi, cela reste un mystère…
Comment mange t-on un éléphant ?
Mai 22, 2020
 Comment mange t-on un éléphant ? Chacun connaît la réponse à ce mantra de coach : bouchée par bouchée, en découpant l’objectif en de petites étapes, chaque étape franchie représentant autant de mini victoires qui mènent au succès final.
Comment mange t-on un éléphant ? Chacun connaît la réponse à ce mantra de coach : bouchée par bouchée, en découpant l’objectif en de petites étapes, chaque étape franchie représentant autant de mini victoires qui mènent au succès final.
Avant de commencer l’Idiot de Dostoievski, je n’ai pas pu m’empêcher de penser à cette stratégie apprise en entreprise pour démêler les problèmes les plus complexes. Le livre de 900 pages dans la main, j’ai effeuillé les pages en tentant de repérer les parties et les chapitres qui me permettraient de manger l’éléphant par petits morceaux : deux parties, une trentaine de chapitres, une trentaine de pages par chapitre, restait à voir le goût de la chair du mastodonte dont j’ai commencé la lecture au tout début du confinement. Pourquoi à ce moment-là ? Prémonition que l’éléphant ne se laisserait pas manger facilement, état d’esprit propice au gros livre, tentative de retrouver le sentiment à la fois euphorique et terrassant éprouvé après avoir fini Crime et Châtiment ?
 L’éléphant est là, énorme et imposant. Il se laisse consommer, à la première impression pourtant, la chair est un peu fade : l’Idiot, c’est l’histoire d’un idiot (épileptique en réalité), pauvre mais qui devient riche par la magie de son titre (prince) et d’un héritage qui tombe à pic, et qui va tour à tour tomber amoureux de deux des jeunes filles du livre qu’on cherche à marier. La première, Nastassia Vilipovna, à la beauté remarquable, joue avec les prétendants dont elle ne manque pas en mettant sa propre main aux enchères. Souillée par son tuteur qui l’a recueillie orpheline et a abondamment abusé d’elle dès ses douze ans, elle a été dotée par ce dernier pour tout de même se faire une petite place dans la société russe. La seconde, Aglae, est la cadette d’une fratrie de trois filles, lointaines cousines du prince et que leurs parents cherchent à marier à tout prix. Vive mais chipie, elle joue avec les sentiments du prince qui pourtant s’amourache de son esprit pétillant.
L’éléphant est là, énorme et imposant. Il se laisse consommer, à la première impression pourtant, la chair est un peu fade : l’Idiot, c’est l’histoire d’un idiot (épileptique en réalité), pauvre mais qui devient riche par la magie de son titre (prince) et d’un héritage qui tombe à pic, et qui va tour à tour tomber amoureux de deux des jeunes filles du livre qu’on cherche à marier. La première, Nastassia Vilipovna, à la beauté remarquable, joue avec les prétendants dont elle ne manque pas en mettant sa propre main aux enchères. Souillée par son tuteur qui l’a recueillie orpheline et a abondamment abusé d’elle dès ses douze ans, elle a été dotée par ce dernier pour tout de même se faire une petite place dans la société russe. La seconde, Aglae, est la cadette d’une fratrie de trois filles, lointaines cousines du prince et que leurs parents cherchent à marier à tout prix. Vive mais chipie, elle joue avec les sentiments du prince qui pourtant s’amourache de son esprit pétillant.
L’écrivain a choisi une cuisson lente pour cette histoire d’amour a priori banale : il ne se passe que quelques mois entre le premier chapitre qui met en scène les trois principaux protagonistes mâles et la conclusion dramatique qui réunit à nouveau deux d’entre eux. Entre ces deux moments intenses défilent 900 pages de très longues scènes dialoguées où se mêlent des dizaines de personnages puisque chaque protagoniste est entouré d’un père, d’une mère, de frères, de sœurs, de prétendants, d’amis, d’un parrain, d’une marraine, de locataires, etc. qui participent aux longues conversations.
Pendant une bonne partie de l’histoire, Dostoievski réunit ses personnages à Pavlovsk, un lieu de vacances de la bonne société pétersbourgeoise. Au centre, le prince idiot détonne par son authenticité là où son entourage n’est que petitesses et faux-semblants. Par sa simplicité et son innocence, il s’impose comme maïeuticien de la bourgeoisie oisive qui l’entoure pour parler de Dieu, de la mort, de l’amitié, de l’amour propre, de l’égoïsme, de l’argent, de la compassion, de la liberté, de l’athéisme, de la grandeur de la Russie, etc. D’amour, il en est question bien sûr, mais la nécessité pour les femmes d’entrer dans un mariage conventionnel semble brouiller tous les sentiments réels, l’amour se résume à une dot et à une signature en bas d’un contrat.
Trente chapitres de trente pages : bien sûr, ce n’est pas comme ça qu’on est censé lire un livre, un livre ne peut pas se résumer au numéro de la page atteinte le soir quand on le repose sur sa table de chevet. C’est pourtant le sentiment qu’il m’en reste : d’avoir mangé chaque morceau de l’éléphant mais en peinant, en devant m’arrêter pour déglutir et aiguiser à nouveau mon appétit, en prenant chaque morceau un par un sans le plaisir de me sentir envahie par l’histoire et d’oublier que je lisais une légende. J’ai mangé l’éléphant, je l’ai digéré, mais je ne l’ai pas aimé, je mangerai une souris la prochaine fois.
De la folie, vraiment ?
mars 8, 2020
Cinq fois… il m’a bien fallu relire cinq fois les cinquante premières pages de Crime et Châtiment pour enfin rentrer dans le livre. Le début du roman a sa dose de misère humaine, de pauvreté, de vies détruites par la paresse et l’alcool, d’inégalités criantes, de privilèges hérités, il me semble bien que c’est cette misère à pleurer du début du livre qui m’a retenue d’y entrer plus avant. Et puis il a fallu comprendre que chaque personnage avait deux prénoms et un nom, ensuite un diminutif et encore un diminutif du diminutif avant de se lancer plus avant, en recherchant régulièrement où et quand chacun était apparu, et quel était son lien avec le héros (merci la fonction « search » du kindle).
 Et puis lorsque j’ai compris que Dostoievski n’était pas là pour enjoliver le monde mais bien pour nous raconter des morceaux de vies en Russie au XIXème siècle, je me suis accrochée, et là s’est ouvert l’univers gigantesque de l’auteur : un personnage principal mais aussi des personnages secondaires fouillés jusqu’au tréfonds de leur personnalité, qui apparaissent discrètement au tout début du livre et que Dostoievski fait apparaître plus loin, plus tard, parfois même jusqu’à leur mort, pour de longues tranches de vie. Les personnages de Dostoievski nous parlent même de morts que l’auteur ne fera jamais intervenir dans ses longs dialogues mais qu’il nous semble aussi bien connaître que les vivants. Et puis au bout du bout, c’est l’histoire du héros Raskolnikov qu’il écrit, mais aussi celle de sa sœur, de sa mère, du fiancé de sa sœur, de celle que lui finira par aimer, du père, de la belle-mère et des demi-frère et sœur de celle qu’il finira par aimer, de son ami, des employeurs de sa sœur, du procureur du quartier, de policiers, de la gardienne, de la sœur de la gardienne, des ouvriers intervenus dans son immeuble, etc.
Et puis lorsque j’ai compris que Dostoievski n’était pas là pour enjoliver le monde mais bien pour nous raconter des morceaux de vies en Russie au XIXème siècle, je me suis accrochée, et là s’est ouvert l’univers gigantesque de l’auteur : un personnage principal mais aussi des personnages secondaires fouillés jusqu’au tréfonds de leur personnalité, qui apparaissent discrètement au tout début du livre et que Dostoievski fait apparaître plus loin, plus tard, parfois même jusqu’à leur mort, pour de longues tranches de vie. Les personnages de Dostoievski nous parlent même de morts que l’auteur ne fera jamais intervenir dans ses longs dialogues mais qu’il nous semble aussi bien connaître que les vivants. Et puis au bout du bout, c’est l’histoire du héros Raskolnikov qu’il écrit, mais aussi celle de sa sœur, de sa mère, du fiancé de sa sœur, de celle que lui finira par aimer, du père, de la belle-mère et des demi-frère et sœur de celle qu’il finira par aimer, de son ami, des employeurs de sa sœur, du procureur du quartier, de policiers, de la gardienne, de la sœur de la gardienne, des ouvriers intervenus dans son immeuble, etc.
Unité de temps, unité d’action, unité de lieu, l’histoire de 650 pages ne s’étend sans doute pas plus que sur quelques jours, et outre l’épilogue, les scènes se partagent dans les quelques pièces habitées par les principaux protagonistes dans de longs, très très longs dialogues, avec très peu de scènes en extérieur. Parlons-en de ces longs dialogues, le sentiment incroyablement vivant qui se détache du livre vient sans doute de là : toute l’action se fait dans des dialogues, les descriptions sont très courtes, c’est une longue et intense pièce de théâtre qui se joue sous nos yeux. La force et la longueur de ces dialogues imprime sur leurs personnages une intensité rarement lue.
Car il s’agit d’eux, et d’eux, nous finirons par savoir beaucoup, de leurs forces et leurs faiblesses, de leurs espoirs et leurs renoncements ; et puis de l’orgueil, de la vanité et de l’amour-propre qui poussent Raskolnikov à tuer, de la finitude de l’homme puisqu’il n’est question, au final que de ça, et de comment vivre (ou ne pas vivre) avec ça. A travers ses personnages, c’est aussi de grandes questions philosophiques dont nous parle Dostoievski : le bien et le mal, la rédemption, le pardon, l’effort et la paresse, la foi et la croyance, le déterminisme, les normes sociales, la justice humaine, mais aussi de questions de société qui permettent d’envisager sur quel sol a pu se nourrir le communisme : les rentes de situation, l’héritage, le sort économique et par là, humain, épouvantable des femmes et des enfants, les ravages de l’alcool, les conditions de travail effroyables de ceux qui travaillaient, la fragilité de la vie face à la maladie physique ou psychique.
J’ai fini par dévorer les deux derniers tiers du livre, je l’ai refermé tout à l’heure sur un épilogue plein d’espoir et avec le sentiment qu’après avoir lu un tel monstre, après avoir peiné puis joui d’un tel roman, il fallait, comme Raskolnikov au bagne, en Sibérie, un jour, remplacer la dialectique par la vie, et remplacer la littérature par la vie. Alors je suis sortie.
La mère
mars 1, 2020
 « Toute démarche poétique consiste à retrouver et à exalter la souffrance originelle enfouie au fond de chacun de nous. », c’est Michel Houellebecq qui le dit. Pour nombre d’écrivains (et chez nous aussi, non écrivains ?), la souffrance originelle se trouve dans la famille, pour Delphine de Vigan, elle vient indéniablement de sa mère.
« Toute démarche poétique consiste à retrouver et à exalter la souffrance originelle enfouie au fond de chacun de nous. », c’est Michel Houellebecq qui le dit. Pour nombre d’écrivains (et chez nous aussi, non écrivains ?), la souffrance originelle se trouve dans la famille, pour Delphine de Vigan, elle vient indéniablement de sa mère.
La famille, c’est un sujet intarissable, source inépuisable d’anecdotes, de manies, d’idiosyncrasies, de rites vécus que l’imaginaire parvient rarement à égaler, ou que l’imaginaire serait accusé d’excès ou d’irréalisme s’il le concevait.
La famille, c’est un sujet qui fédère et qui ancre l’écrivain dans le réel du lecteur. Car qui, en lisant les souvenirs d’un Antoine de Saint-Exupéry, d’un Romain Gary ou d’un François Mauriac, n’a pas retrouvé chez la tante folâtre de l’un, le père distant de l’autre ou la mère dépressive d’un troisième un peu de soi, de sa propre famille ou de ses propres angoisses. La famille de l’autre joue comme un miroir, l’écrivain n’est plus seulement témoin de sa propre histoire, il devient témoin de l’histoire du lecteur dont il écrit une petite partie.
Enfin, la famille, c’est un sujet impudique car il faut bien parvenir à se délester de la honte ou de la retenue qui brouillent les souvenirs pour aller y rechercher la part noire. Les vices, les manquements et les secrets inavouables du groupe qui nous a fait naître font peut-être plus ce que nous sommes que la part éclatante et affichable de cette même histoire.
Tout cela, c’est de la théorie. En pratique, Delphine de Vigan parle de sa mère et de sa famille maternelle avec une simplicité troublante dans « Rien ne s’oppose à la nuit ». L’auteure s’inquiète tout au long du roman des réactions de sa sœur et de ses tantes à l’opus qui met à nu une partie de leur histoire mais elle le fait avec une sincérité qui, je le lui souhaite, a balayé ses craintes.
Delphine de Vigan et sa sœur ont pris très tôt leur vie en main pour pallier les insuffisances éducatives de leur mère : l’inversion des rôles imposée par la maladie d’une mère à deux enfants met en lumière l’évidente chance d’appartenir à une cellule familiale où chacun, parents et enfants, suit sa partition. Delphine de Vigan s’est offert et nous offre par la même occasion une longue séance de psychothérapie. Ou peut-être a t-elle trouvé le moyen, par ce livre sublime, de consommer le deuil d’une mère pour laquelle elle crie son amour ?